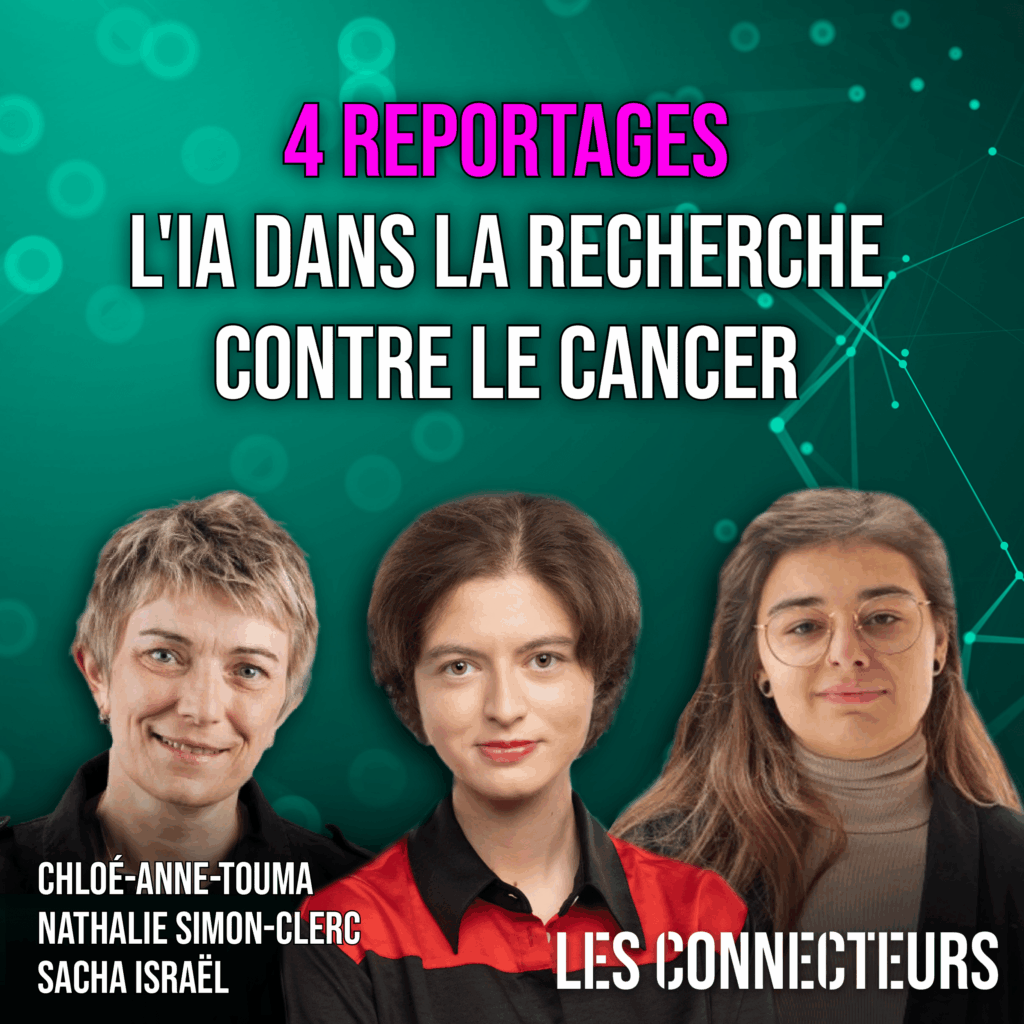Décoder l’épigénome grâce à l’IA : vers une médecine de précision pour le cancer
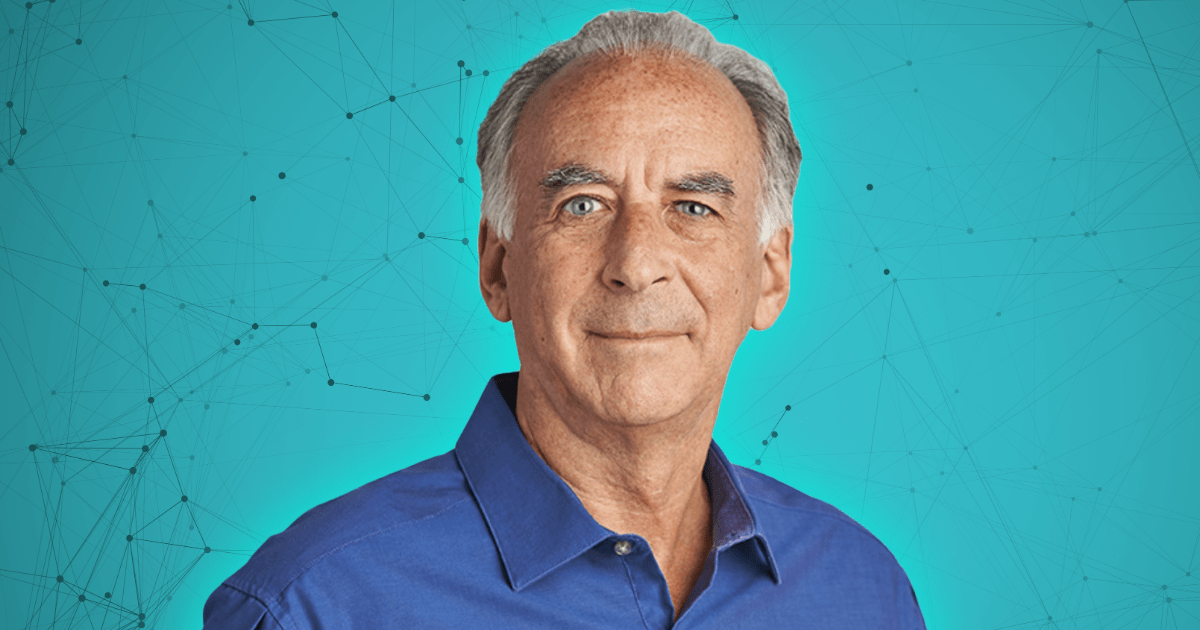
Par Sacha Israël, journaliste pour LES CONNECTEURS | Publié le 8 mai 2025
Et si l’intelligence artificielle, combinée à l’étude de l’épigénome, devenait l’arme ultime contre le cancer? C’est l’axe d’étude du projet de Jacques Drouin, chercheur à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), et de son co-chercheur Marc Bellemare de l’Université McGill. L’IA, utilisée à des fins d’analyse et de découverte, constitue dans ce projet un réel levier dans la prise en charge des cancers, dont l’objectif est de permettre la pose de diagnostics précoces et l’obtention de traitements personnalisés.
Le concours « Données omiques contre le cancer (DOCC) », lancé en 2020 par Génome Québec, l’Oncopole (pôle cancer du Fonds de recherche du Québec) et IVADO, vise à promouvoir la recherche multidisciplinaire en intelligence artificielle, en sciences omiques et en cancérologie, dans le but de soutenir le développement d’applications et d’outils d’IA qui pourront exploiter les données au profit des traitements contre le cancer. C’est grâce à cette initiative que des projets de recherche comme celui du professeur Drouin, financé à hauteur de 300 000 $, ont vu le jour. Notre rédaction s’entretient avec le chercheur pour en apprendre davantage sur ses avancées, et les résultats espérés.
Un portrait biologique
Épigénome
L’épigénome, que l’on peut décrire comme un ensemble de règles d’utilisation, contient toutes les instructions nécessaires dans la fabrication des protéines et d’autres molécules essentielles au fonctionnement des cellules.
Il agit comme un système, un mécanisme qui régule l’activation ou l’inactivation des parties de l’ADN. On peut ainsi dire que l’épigénome se compose principalement de modifications chimiques sur l’ADN ou les protéines qui l’entourent.
« L’épigénome, c’est l’ensemble des protéines qui emballent l’ADN et qui le présentent à la machinerie d’expression des gènes, de telle sorte que certaines portions du génome soient accessibles (…) »
« L’épigénome, c’est l’ensemble des protéines qui emballent l’ADN et qui le présentent à la machinerie d’expression des gènes, de telle sorte que certaines portions du génome soient accessibles, et qu’il soit permis d’exprimer les gènes, qui s’expriment en fonction de leurs modalités propres », décrit Jacques Drouin.
Comme l’explique le chercheur, ces modifications déterminent si des parties de l’ADN sont ouvertes (actives et utilisables) ou fermées (compactées et inactives). Cela signifie ainsi que les régions de l’ADN exprimées sont utilisées pour produire des molécules, tandis que d’autres restent silencieuses.
C’est ce mécanisme de l’épigénome qui régule les gènes et dont la perturbation peut avoir des conséquences néfastes, comme des cancers, où le contrôle de l’expression des gènes est souvent défaillant. Une perturbation de ce mécanisme entraîne ainsi l’activation de gènes dangereux ou l’inactivation de gènes protecteurs, contribuant à la progression de la maladie.
Facteurs de transcription
Ces protéines responsables de la régulation des gènes sont les facteurs de transcription qui jouent un rôle essentiel pour déterminer quels gènes seront activés (ou exprimés) au bon moment et dans les bonnes cellules. Elles marquent ainsi une importance significative dans le corps, activant les gènes qui contrôlent la digestion que dans les cellules du foie et de l’intestin, et non pas dans les cellules du cerveau, par exemple.
Jacques Drouin met ainsi l’emphase sur les facteurs pionniers dans la description de son projet, qui sont une catégorie spécifique de protéines appartenant aux facteurs de transcription. Ces facteurs pionniers, le chercheur les décrit comme des protéines dont la particularité est de pouvoir ouvrir des parties de l’ADN qui sont normalement compactées et inaccessibles.
« Cela fait seulement 10 ou 15 ans que l’on a identifié ces facteurs, puis qu’on commence à comprendre comment ils agissent. »
« Ces facteurs-là peuvent avoir un rôle pionnier pour ouvrir de la chromatine fermée, et permettre l’expression de gènes qu’il n’était pas possible d’exprimer au préalable. On travaille alors sur ces pionniers depuis longtemps pour comprendre leurs mécanismes d’action. Cela fait seulement 10 ou 15 ans que l’on a identifié ces facteurs, puis qu’on commence à comprendre comment ils agissent », précise le professeur Drouin.
Ces facteurs semblent ainsi agir comme des éclaireurs, puisque le chercheur soutient qu’en causant cette ouverture, « ils mettent en place des marques épigénétiques, qui sont la signature de séquences actives et de gènes actifs. »
Marques et signatures épigénétiques
Une signature épigénétique est ainsi une combinaison spécifique de marques épigénétiques observées dans une cellule donnée. Ces marques et signatures aident à mieux comprendre comment une cellule fonctionne et comment elle devient malade, puisque dans un cancer, la signature épigénétique est différente de celle d’une cellule saine. Cela aide alors à identifier les régions du génome qui ont été activées ou réprimées de manière anormale.
Pourtant, ces marques épigénétiques révèlent certaines limites, comme l’explique Jacques Drouin. Il souligne notamment que 99 % des marques restent mal comprises. Leur existence est connue, mais leurs rôle et signification sont encore flous.
Il est ainsi nécessaire, selon lui, de perturber le système pour mieux comprendre quelles marques sont liées à l’activation ou à la répression des gènes.
« Ce n’est pas facile de comprendre ces différentes marques tant qu’on n’a pas réussi à les perturber, à les changer et à les comparer dans différentes cellules (…) On peut prendre une cellule dans laquelle le pionnier agit, ouvre des parties de chromatines fermées et change la signature épigénétique, pour que l’on puisse maintenant identifier les marques qui correspondent aux gènes qui sont maintenant actifs. On a un état avant et après le pionnier, c’est-à-dire qu’on peut perturber le système », ajoute Jacques Drouin.
L’IA pour comprendre et analyser le génome
Ce qu’il faut surtout savoir sur les marques épigénétiques, c’est qu’elles contiennent une quantité massive de données qui est complexe à comprendre et analyser.
« Ce qu’on a voulu développer, ce serait un algorithme d’intelligence artificielle qui est véritablement intelligent, dans le sens où il découvre des choses qu’on n’a pas su découvrir auparavant. »
« Ce qu’on a voulu développer, ce serait un algorithme d’intelligence artificielle qui est véritablement intelligent, dans le sens où il découvre des choses qu’on n’a pas su découvrir auparavant », mentionne le chercheur.
Ce constat a ainsi mené à mettre l’intelligence artificielle au cœur du projet des deux chercheurs, qui la voient comme un outil pour détecter des changements épigénétiques et identifier des motifs ou signatures inconnus dans l’épigénome.
Selon Jacques Drouin, l’objectif est de mettre en place un algorithme d’intelligence artificielle permettant de signaler l’apparition de nouvelles marques ainsi que d’identifier celles qui parviennent avec difficulté à être analysées depuis leur découverte : « Au-delà de reconnaître la signature de l’épigénome, c’est dans tout le génome. Est-ce qu’il y a des signatures qui sont présentes 100 fois, 3 fois, 1 000 fois dans le génome, qu’on n’aurait jamais reconnues? Autrement dit, on parcourt tout le génome avec lui-même, toutes ses parties pour essayer de reconnaître des nouveaux patrons », conclut le chercheur.
Une prise en charge des cancers plus efficace
Cette approche basée sur les signatures épigénétiques, mêlée aux découvertes de l’IA, pourrait ainsi avoir un impact majeur dans la prise en charge des cancers.
Analyser et comparer les signatures épigénétiques des cancers permet ainsi de détecter des perturbations dans l’expression des gènes, menant à des diagnostics précoces. Jacques Drouin soutient notamment que chaque cancer, même lorsqu’il porte le même nom qu’un autre, peut en avoir des dérèglements génétiques et spécifiques différents, et que l’analyse de la signature épigénétique d’un cancer permettrait de mieux comprendre ce qui est déréglé pour adapter les traitements en conséquence.
« En développant des signatures épigénétiques pour un cancer, on développe une appréciation beaucoup plus précise de ce qui est déréglé dans ce cancer par rapport à d’autres. On a donc une utilisation potentielle très puissante dans le diagnostic précoce de différentes formes de cancers. »
Cette approche ouvre également la voie au développement de thérapies sur mesure, ciblant précisément les anomalies spécifiques de chaque type de cancer.
Ce projet, bien que prometteur, cible encore des objectifs pour l’avenir, notamment celui de simplifier les analyses épigénétiques pour les rendre accessibles et efficaces, même avec un minimum de matériel biologique. Optimiser cette approche aurait ainsi des retombées pour la démocratisation à l’échelle de la pratique clinique.