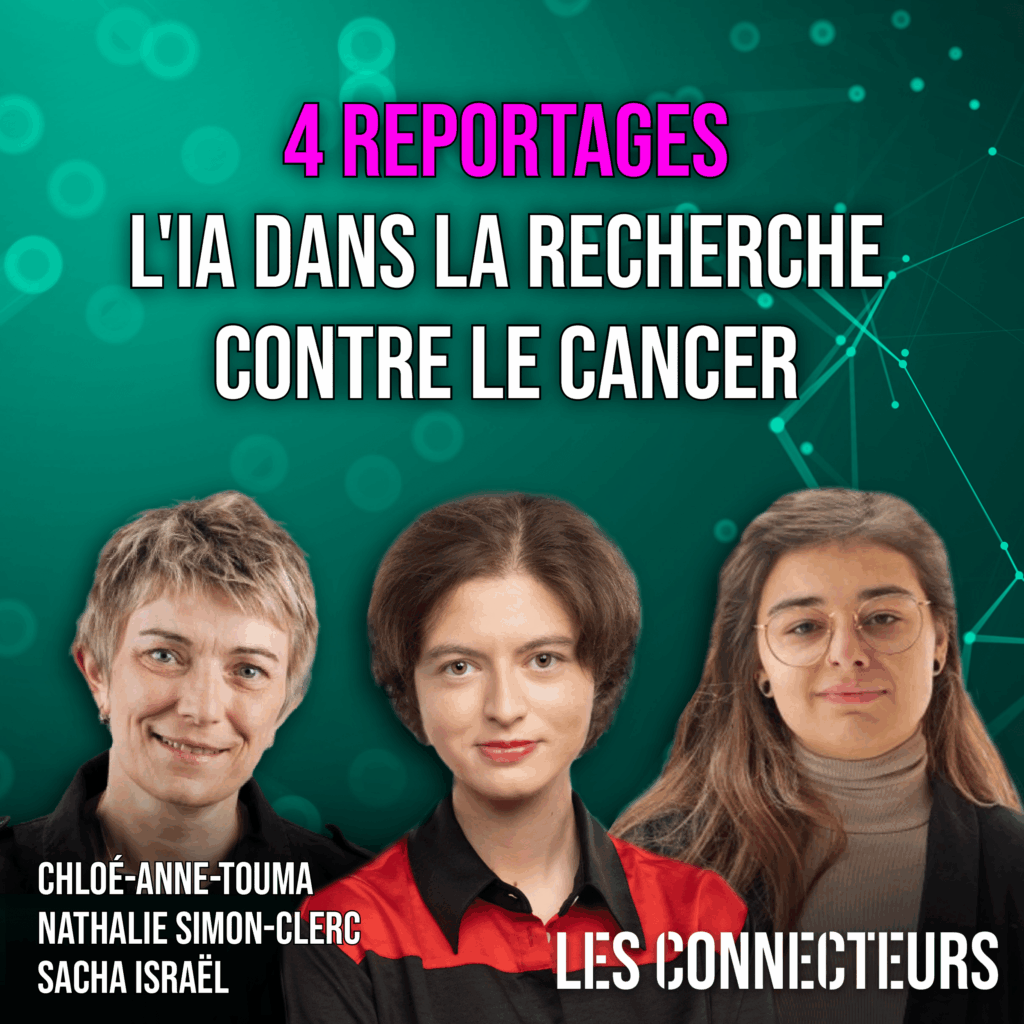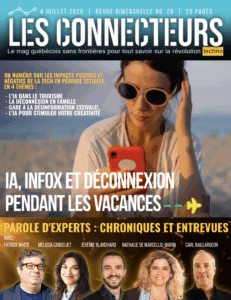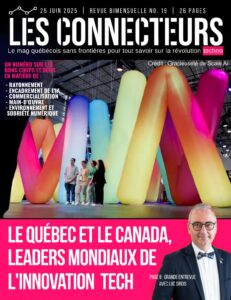Les données de santé
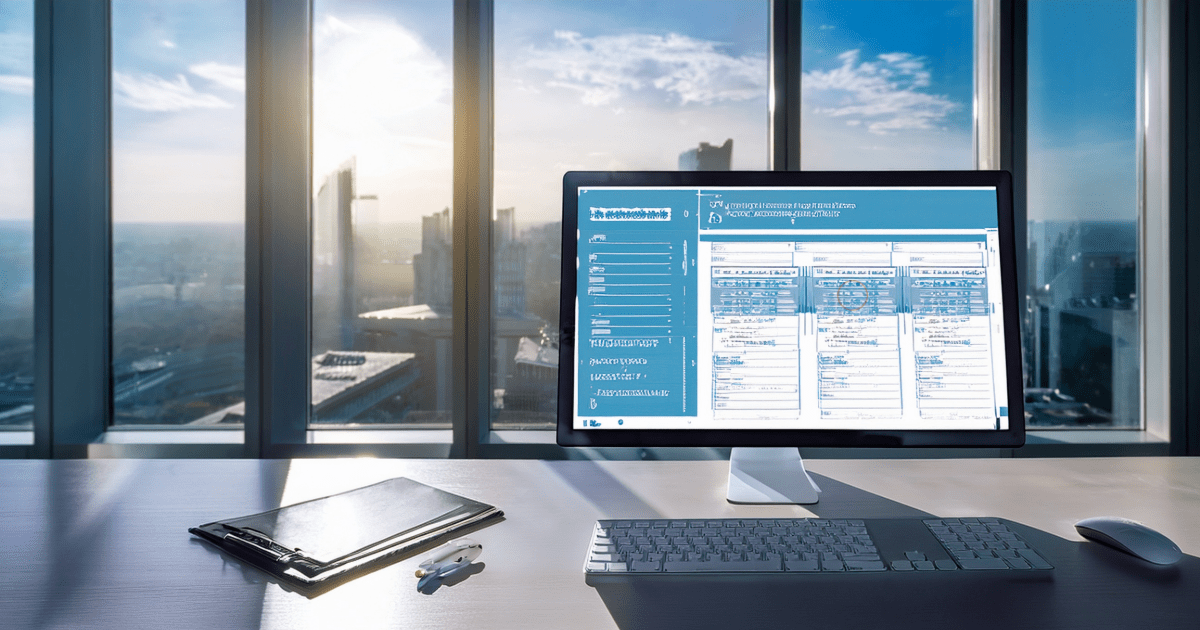
Une chronique de Joane Siksous | Publiée le 1er avril 2025
En matière de santé, la qualité des données, c’est une question de vie ou de mort…
Lire cette chronique telle que parue initialement dans la revue animée et interactive, ou poursuivre la lecture.
Prenons l’exemple d’un patient qui a récemment développé une allergie sévère à un anesthésiant. Les données du patient n’ont pas été mises à jour faute de temps, et il est amené aux urgences d’un hôpital loin de son lieu de rattachement, à la suite d’un accident de voiture. L’équipe médicale consulte le dossier du patient qui n’est pas à jour, et utilise, sans le savoir, le produit anesthésiant auquel il est allergique. C’est le drame…
« (…) il faut donc que des données à jour soient disponibles en temps réel pour les professionnels de la santé. »
Pour avoir un système de santé efficace et sécuritaire, il faut donc que des données à jour soient disponibles en temps réel pour les professionnels de la santé.
Mais les choses se compliquent lorsque l’on parle d’exactitude de données. Prenons le même patient dont les données sont entrées en temps utile cette fois, mais avec une petite faute d’orthographe qui s’est glissée par inadvertance dans son nom de famille, lors de la saisie. Le système va traiter cette allergie comme celle d’un autre patient. L’information critique ne sera pas disponible lors de l’opération. Et c’est encore le drame…
Pour protéger les patients adéquatement, il faut donc que les données soient exactes, consolidées et réconciliées, pour être corrigées en continu et en temps réel.
Mais ce n’est pas tout! Imaginons maintenant que notre patient ait un homonyme, qu’une personne, donc, ait le même nom, et soit née à la même date. L’allergie est cette fois saisie à temps, et avec la bonne orthographe, mais dans le dossier de l’autre patient du même nom! Et c’est, pour la troisième fois, le drame…
Alors, comment faire? Il faut que le système soit équipé d’une solution de résolution d’entité performante qui établit, en temps réel, quels enregistrements sont des doublons pour la même personne, et quelles données similaires ou identiques correspondent à des individus distincts.
Consolider les données médicales des Québécois : un chantier pharaonique
Pour centraliser et consolider les données médicales des Québécois, le gouvernement a mis en place le Dossier Santé Québec (DSQ). L’objectif est de permettre aux professionnels de la santé de consulter rapidement les antécédents médicaux d’un patient.
Mais ces données ont un volume massif, une variété de formats –texte, radiographies, etc. et sont réparties dans une multitude de systèmes et de fichiers localisés partout au Québec. La mise en place du DSQ fut donc un projet pharaonique, dont l’adoption reste encore incomplète en raison de son ampleur. Le système est parfois jugé obsolète, son ergonomie peu intuitive et des problèmes d’interopérabilité entre les différents logiciels utilisés dans le réseau de la santé subsistent encore.
Prenons l’exemple d’une infirmière atteinte d’un cancer qui postule dans une clinique privée. Elle doit pouvoir protéger la confidentialité de son dossier médical pour ne pas subir de discrimination à l’embauche.
Un autre problème de taille : les données historiques des patients. Si le DSQ est aujourd’hui fonctionnel pour les nouvelles entrées, qu’en est-il des informations accumulées avant son déploiement? Ces données sont cruciales, notamment pour prévenir l’apparition de maladies chroniques et assurer un suivi à long terme. Or, elles sont souvent dispersées dans d’anciens dossiers papier ou stockées sur des fichiers Excel, un mode de gestion des données inadapté aux exigences de disponibilité, de sécurité et de protection actuelles.
Soigner les patients et protéger leur confidentialité : un équilibre délicat
L’un des enjeux majeurs du DSQ et de la numérisation des données de santé est la protection de la vie privée. Si ces informations sont indispensables aux médecins et infirmiers, elles ne doivent pas être accessibles à n’importe qui. Comment garantir qu’un employeur, un assureur ou même un collègue de travail n’ait pas accès à des informations sensibles?
Prenons l’exemple d’une infirmière atteinte d’un cancer qui postule dans une clinique privée. Elle doit pouvoir protéger la confidentialité de son dossier médical pour ne pas subir de discrimination à l’embauche. Cela pose la question du consentement et du contrôle des accès aux données.
Aujourd’hui, des mécanismes existent pour encadrer ces accès. La Loi 5 prévoit des restrictions et des autorisations granulaires, permettant à un patient de limiter l’accès à certaines informations. Mais en pratique, la mise en application de ces mesures est complexe et requiert des compétences et solutions techniques dont le système de santé québécois ne dispose pas encore.
Un système à moderniser
Le secteur public doit aujourd’hui composer avec un paradoxe : des exigences accrues en matière de sécurité et de protection des données, mais des infrastructures informatiques souvent vieillissantes. De nombreux établissements utilisent encore des systèmes hérités du passé qui ne permettent pas une gestion optimale des informations de santé.
Des solutions efficaces existent aujourd’hui pour contrôler les accès, les solutions de gouvernance de données. Il existe également des outils très performants de résolution d’entité qui créent en temps réel une donnée unique de qualité. Il existe enfin des solutions récentes de gestion automatisée et sécuritaire de la confidentialité. Cependant, le déploiement de ces solutions requiert une prise de conscience des impacts de la qualité, la gouvernance et la confidentialité des données sur le système de santé, les professionnels de la santé, et finalement les patients eux-mêmes. Des investissements significatifs et un leadership éclairé sont nécessaires pour mener à bien un projet de modernisation des systèmes qui pourra seul garantir l’accessibilité des données aux professionnels de la santé et leur protection contre les usages abusifs. Parce qu’en matière de santé, l’erreur n’est pas une option.