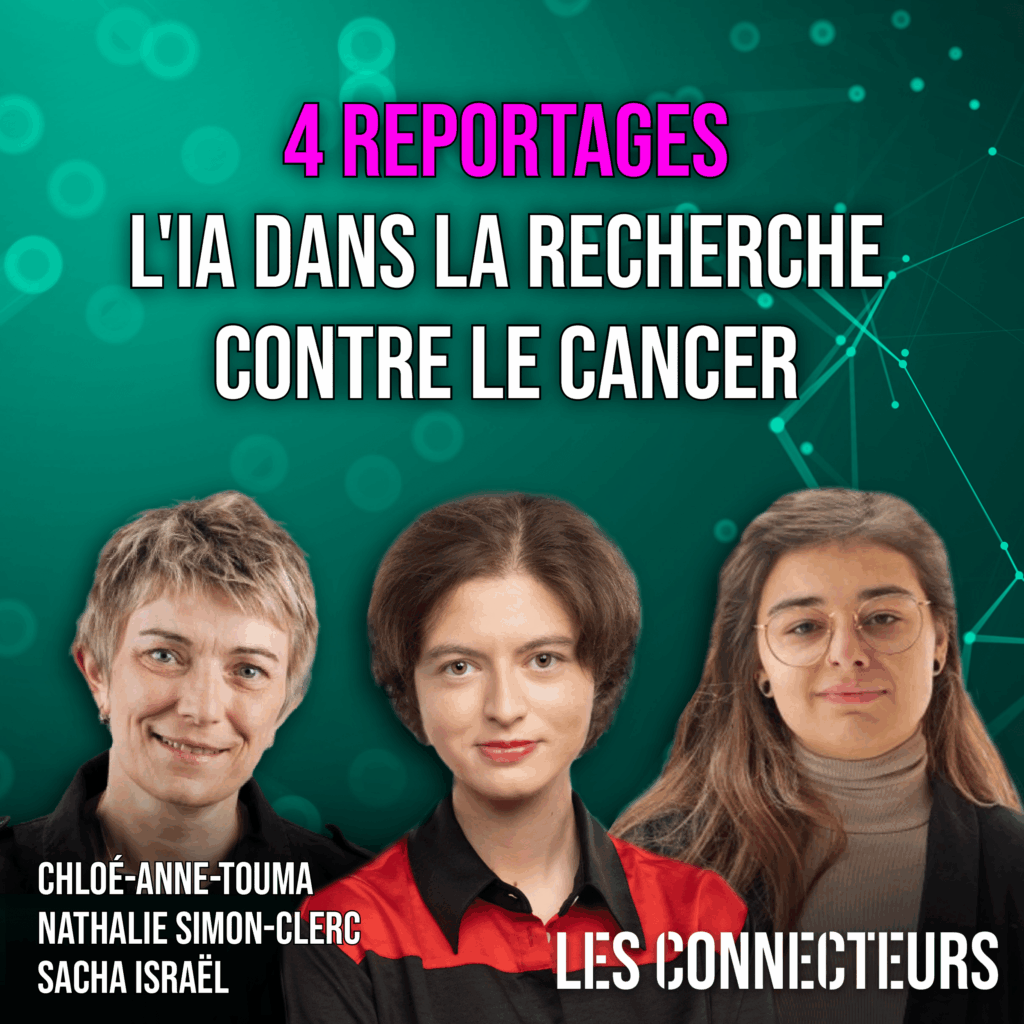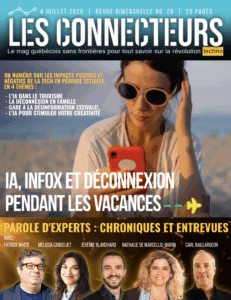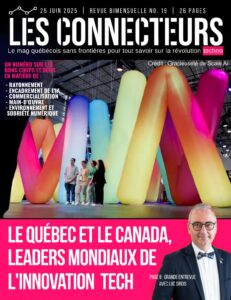Le premier portrait de l’écosystème foodtech au Canada

Par Julie Daigle, chroniqueuse pour LES CONNECTEURS | Chronique publiée le 18 avril 2025
Les entreprises alimentaires canadiennes font face à un défi générationnel : nourrir une population grandissante, de manière plus durable, dans une économie mondiale de plus en plus instable. Les changements climatiques, l’incertitude commerciale et la hausse des coûts accélèrent le besoin en innovation transformatrice — et les entreprises technologiques s’imposent pour répondre aux enjeux et besoins existants.
Des protéines végétales à la fermentation de précision en passant par les systèmes de production intelligents et autonomes, les innovateurs canadiens repensent la façon dont les produits alimentaires sont produits et transportés. Le Réseau canadien d’innovation en alimentation (RCIA) vient tout juste de publier le premier portrait de l’écosystème foodtech canadien et propose des actions pour exploiter notre plein potentiel et rendre notre système alimentaire à l’épreuve du futur. Notre pays possède les bases d’un secteur foodtech de calibre mondial. Par contre, sans les infrastructures, le capital et la coordination nécessaires pour soutenir la croissance, le pays prendra du retard.
Voici où nous en sommes, et ce qu’il faudra pour prendre les devants!
Un écosystème prometteur, une croissance freinée : le paradoxe de la foodtech canadienne
L’écosystème foodtech canadien connaît présentement un momentum sans précédent. Le Canada se classe actuellement au 19e rang mondial en matière d’investissements dans la foodtech.
« Le Canada se classe actuellement au 19e rang mondial en matière d’investissements dans la foodtech. »
Le secteur alimentaire technologique canadien a enregistré un taux de croissance annuel moyen (TCAM) des investissements de 8,4 % entre 2018 et 2023, contre -2,6 % à l’échelle mondiale. On compte plus de 240 foodtechs au pays, et elles ont su attirer plus de 2,29 milliards de dollars canadiens d’investissements depuis 2018, en grande partie grâce aux financements publics. L’appui gouvernemental représente environ 30 % du financement de la foodtech au Canada, contre seulement 5 à 8 % aux États-Unis et au Royaume-Uni. De plus, seulement 40 % des rondes de financement dans la foodtech au Canada sont soutenues par du capital de risque, contre 60 % aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Si les startups technologiques canadiennes sont prospères au démarrage et à la phase pilote, les étapes subséquentes demeurent difficiles. Les investissements chutent après les premières rondes de financement et les infrastructures nécessaires à la croissance — comme par exemple, pour le copacking, pour les productions biotechnologiques à échelle pilote (agriculture cellulaire et fermentation de précision) ou pour le soutien réglementaire — restent limitées. En comparaison avec les États-Unis ou l’Europe, le Canada manque de capacité industrielle permettant de transformer des start-up prometteuses en acteurs mondiaux.
Heureusement, nous pouvons notamment compter sur des talents techniques et scientifiques, des ressources agricoles de qualité, une réputation enviable et un marché mondial tourné vers l’innovation durable et la santé. Mais à moins que le Canada ne construise les voies d’accès au capital et à la commercialisation pour accompagner la foodtech, une grande partie de ces entreprises s’essouffleront avant de connaître un succès commercial.
« (…) à moins que le Canada ne construise les voies d’accès au capital et à la commercialisation pour accompagner la foodtech, une grande partie de ces entreprises s’essouffleront avant de connaître un succès commercial. »
Les 3 domaines en plein essor à surveiller
Même si l’écosystème foodtech canadien travaille à surmonter ses lacunes structurelles, certains domaines clés commencent à émerger. Ce sont des secteurs où les entreprises canadiennes gagnent du terrain, attirent du capital et développent des compétences d’envergure mondiale.
Ensemble, ces domaines d’intérêt montrent où se construit déjà l’avenir de la foodtech canadienne — et où des investissements et un soutien continu pourraient générer des retombées positives significatives.
1) Protéines végétales
Le secteur végétal canadien représente désormais 25 % de toutes les entreprises foodtech — soit près du double de la moyenne mondiale. Des investissements d’acteurs comme Roquette, Daiya Foods et Protein Industries Canada ont positionné le pays comme un centre manufacturier B2B pour les ingrédients protéinés végétaux.
2) Aliments fonctionnels issus de la biotechnologie
Pensez aux oméga-3 fermentés, aux agents de conservation à base de champignons et aux protéines issues d’algues. Le Canada dépasse ses attentes dans les catégories « bio-foodtech », grâce notamment à des initiatives gouvernementales, comme la Stratégie de biofabrication et de sciences de la vie du Canada de 2,2 milliards de dollars.
3) Ingrédients revalorisés et innovation contre le gaspillage alimentaire
Le Canada gaspille près de la moitié de la nourriture qu’il produit, mais une vague de start-up inspirantes œuvre à inverser la tendance. Des entreprises comme LOOP Mission au Québec ou encore Crush Dynamics en Colombie-Britannique transforment des aliments gaspillés et des sous-produits industriels en ingrédients à valeur ajoutée ou en produits de consommation, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire.
Pourquoi le Québec excelle
Le Québec joue un rôle essentiel dans l’avenir de la foodtech canadienne. La province représente près de 24 % de la production alimentaire nationale, avec plus de 2 800 entreprises générant plus de 31 milliards de dollars de livraisons annuelles. Elle domine la production nationale dans des secteurs clés — produits laitiers, porc, canneberges et œufs — et est l’une des principales provinces en matière d’investissements en R-D bioalimentaire.
Montréal et la Montérégie sont des pôles majeurs de transformation et d’innovation, représentant ensemble plus de la moitié de la production alimentaire du Québec. À elle seule, Montréal compte 50 start-up foodtech actives, soutenues par un réseau croissant d’accélérateurs et d’institutions de recherche.
Des start-up comme Opalia (lait sans vache issu de cellules mammaires), Still Good (valorisation des coproduits de l’industrie alimentaire) et Relocalize (micro-usines autonomes alimentaires) illustrent la montée en puissance de la province dans les technologies alimentaires de nouvelle génération. Avec une base solide en recherche, en infrastructures de production et en logistique de chaîne d’approvisionnement, le Québec est bien positionné pour faire progresser à l’échelle nationale le développement et l’adoption de solutions foodtech innovantes.
Foodtech au Canada : le moment de vérité
À mesure que les tensions commerciales augmentent et que les chaînes d’approvisionnement transfrontalières deviennent moins fiables, la capacité à transformer davantage d’aliments au niveau national devient une nécessité stratégique. La foodtech offre des solutions concrètes : modernisation des chaînes d’approvisionnement, réduction du gaspillage, allègement de la pression sur la main-d’œuvre et amélioration de la sécurité alimentaire — tout en générant des emplois à forte valeur ajoutée et des innovations prêtes à l’exportation.
Le Canada dispose déjà des ressources naturelles, de la capacité de recherche et du talent entrepreneurial pour devenir un leader. Ce dont les entreprises ont besoin c’est un effort national pour aligner financement, politiques et infrastructures autour de la foodtech afin de répondre aux besoins des entreprises et bâtir un système alimentaire non seulement plus innovant, mais aussi plus résilient et concurrentiel à l’échelle mondiale.
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus, consultez le rapport « Foodtech au Canada : Portrait de l’écosystème 2025 » du Réseau canadien d’innovation en alimentation (RCIA), qui traduit l’analyse la plus complète de l’innovation alimentaire au pays à ce jour. Le rapport est accessible suivant l’inscription gratuite comme membre au RCIA.