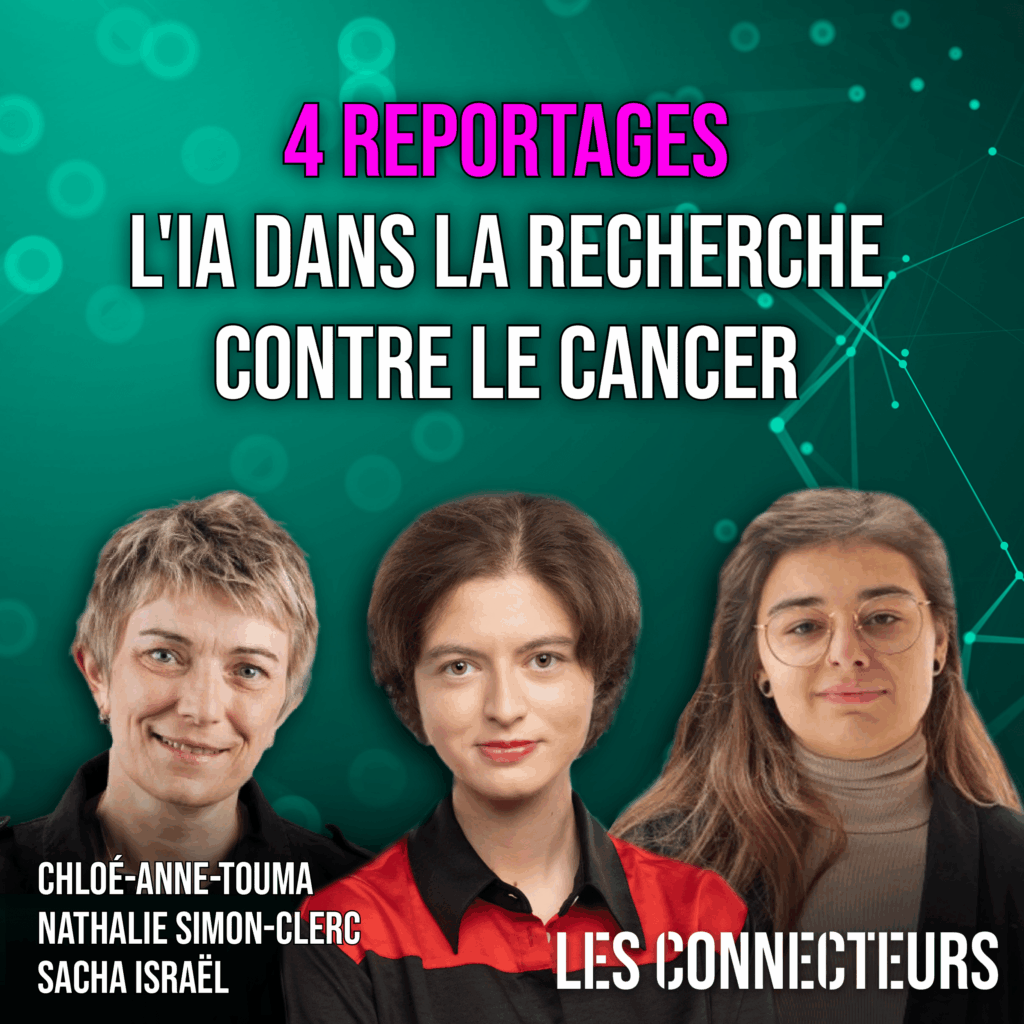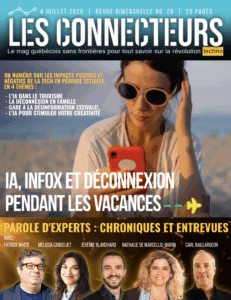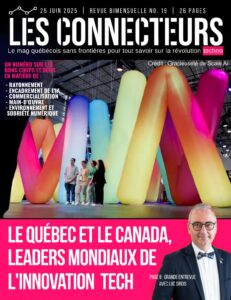T + D = ?
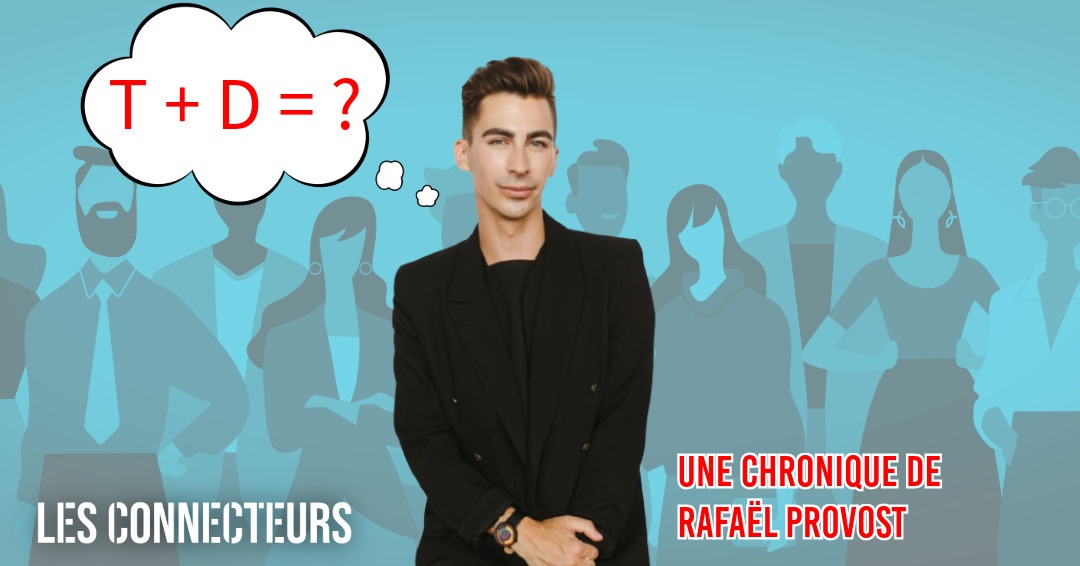
Par Rafaël Provost, chroniqueur pour LES CONNECTEURS | Chronique publiée le 24 avril 2025
La technologie est partout. Elle est dans nos poches, dans nos maisons, dans nos écoles, parfois dans nos corps… Elle promet de connecter, d’augmenter, de simplifier. Et, pourtant, jamais la société n’a semblé aussi fragmentée, polarisée, exposée à des vérités multiples, souvent fabriquées, erronées. Au cœur de ce paradoxe : une équation non résolue de mon côté. T + D = ?
Consultez cette chronique telle que parue initialement dans la revue animée et interactive LES CONNECTEURS, ou poursuivez votre lecture plus bas
« T » pour technologie. « D » pour diversité. Deux moteurs puissants de transformation. Mais additionnés ensemble, ils ne donnent pas encore le progrès espéré. Pourquoi? Parce que cette addition reste incomplète si elle ne s’accompagne pas de responsabilité. Je le dis dans mes mots.
Depuis trop longtemps, les grandes entreprises tech se présentent comme étant neutres. Comme si les algorithmes étaient objectifs. Comme si les plateformes n’étaient que des outils, et non pas des amplificateurs de récits, y compris les plus dangereux. Comme si la désinformation n’était qu’un effet secondaire regrettable, mais inévitable.
Mais rien de tout cela n’est neutre. Rien.
« Lorsqu’on regarde qui est à la tête des géants de la tech, qui conçoit les IA, qui valide les données, qui programme les interfaces, une chose saute aux yeux : l’uniformité. »
Ceux qui créent la technologie façonnent nos regards, nos interactions, nos réactions. Ils décident de ce qui est vu, de ce qui est caché, de ce qui est promu. Et, trop souvent, ils ne ressemblent pas à la diversité du monde qu’ils influencent.
Lorsqu’on regarde qui est à la tête des géants de la tech, qui conçoit les IA, qui valide les données, qui programme les interfaces, une chose saute aux yeux : l’uniformité. Trop peu de femmes. Trop peu de personnes issues de la diversité culturelle, sexuelle (peu s’en vantent du moins), neuroatypique ou socioéconomique. Trop peu de perspectives extérieures au monde techno lui-même.
Le résultat? Des outils conçus sans prendre trop en compte la complexité humaine. Des biais reproduits et renforcés, de façon exponentielle. Et une désinformation qui se propage d’autant plus vite qu’elle trouve, dans les algorithmes, une chambre d’écho parfaite.
La polarisation ne naît pas de nulle part. Elle est nourrie par des bulles, par des suggestions personnalisées, par des systèmes optimisés pour l’engagement, pas pour la vérité. Elle est alimentée par l’absence de garde-fous, par des plateformes qui ne veulent pas « censurer » mais ferment les yeux sur la haine.
Alors, que pourrait valoir cette équation si on la réécrivait?
T + D = transformation.
Une transformation réelle, où la technologie serait co-construite par des voix diverses. Où l’on assumerait que toute innovation a un impact social, culturel, éthique. Où l’on comprendrait que diversifier les talents, c’est aussi enrichir les solutions. Et que se soucier de l’humain, ce n’est pas ralentir le progrès, mais l’humaniser. Prendre le temps, malgré le fait qu’il soit compté, pour mieux faire, pour le faire durer.
« L’avenir ne sera pas uniquement technologique. Il sera techno-responsable, ou il ne sera pas. »
L’avenir ne sera pas uniquement technologique. Il sera techno-responsable, ou il ne sera pas. Et pour y arriver, on doit exiger plus des entreprises qui façonnent nos mondes numériques : plus de transparence, plus de régulation, plus d’éthique, plus de représentativité.
Plus d’humanité.
Diversité sans technologie, c’est souvent un vœu pieux. Technologie sans diversité, c’est un danger. Je le nomme aussi.
Et si la vraie équation était plutôt : (T + D) × R = Avenir?
Technologie plus diversité, multiplié par la responsabilité, égal à un avenir plus juste, sain, plus humain, plus durable.
C’est l’avenir que je nous souhaite…