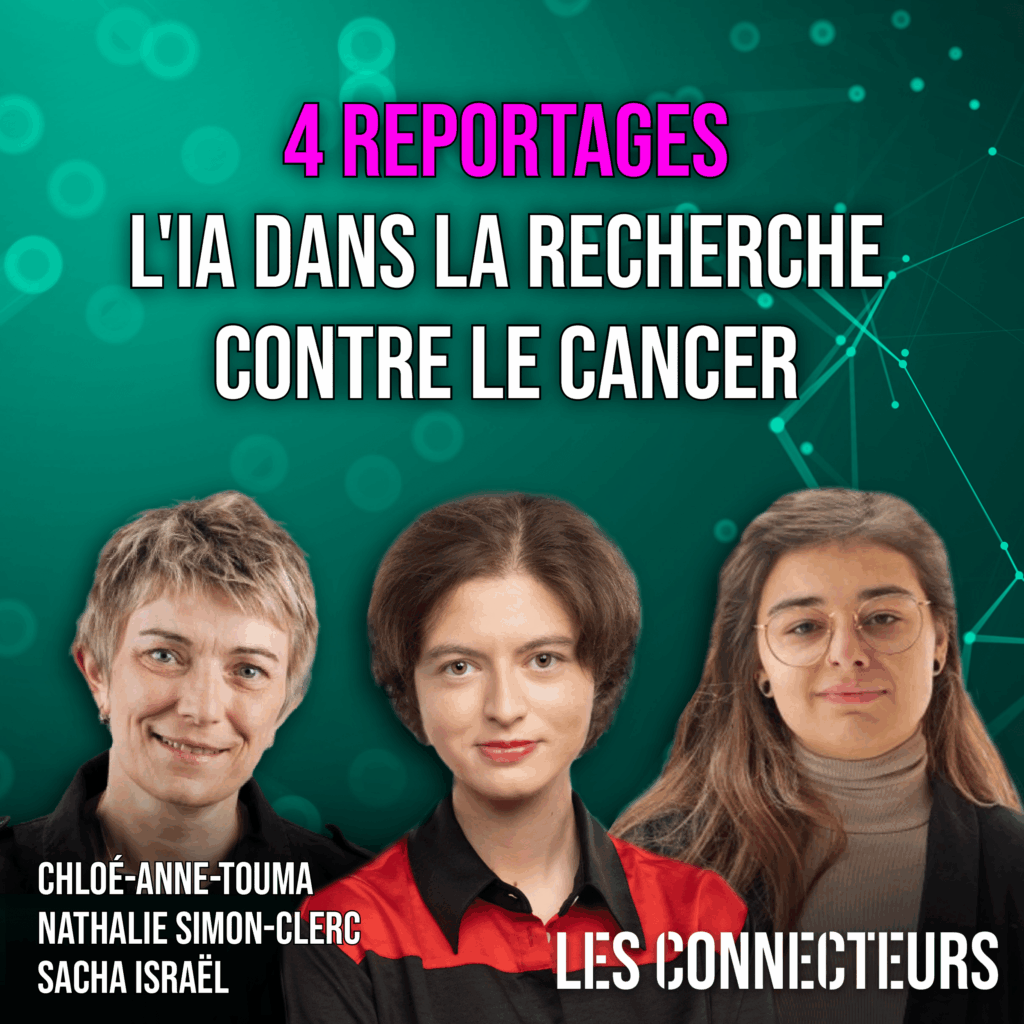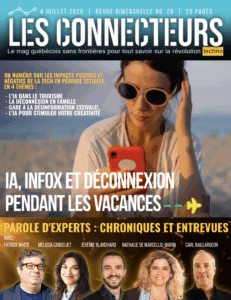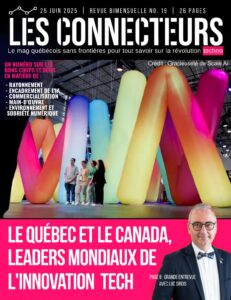Améliorer la commercialisation canadienne de la recherche en sciences de la vie

Par Ruby Jing Zhao, chroniqueuse pour LES CONNECTEURS | Chronique publiée le 21 avril 2025
Lire cette chronique telle que parue initialement dans la revue animée et interactive LES CONNECTEURS, ou poursuivre la lecture sur cette page
Depuis plus d’un siècle, le Canada a eu un impact mondial dans les sciences de la vie, apportant des contributions majeures à la santé publique et personnelle. De la découverte de l’insuline par Sir Frederick G Banting en 1920, au développement de la première « bombe au cobalt » pour traiter le cancer par Ivan Smith à l’Université Western en 1951, à la découverte des cellules souches par les scientifiques de l’Université de Toronto, James Till et Ernest McCulloch en 1961, à la découverte de médicaments antiviraux sauvant des vies contre le VIH à Montréal par Mark Wainberg en 1989, jusqu’à l’invention du premier stimulateur cardiaque externe au monde par le Dr John Hoops au Conseil national de recherches du Canada à Ottawa en 1950, et bien d’autres encore.
« Au Canada, les start-up en biotechnologie passent souvent trop de temps dans des laboratoires académiques en raison du coût des installations, du manque d’espace et du manque d’incitatifs. »
En particulier, pour un pays avec autant de recherches pionnières, de recherche et développement (R-D) de classe mondiale et d’un écosystème couvrant des universités de premier plan, des centres de recherche, des PME et des multinationales, la commercialisation — c’est-à-dire la traduction de la recherche en succès commercial — représente un défi de longue date. L’écosystème canadien des sciences de la vie est en grande partie soutenu par des systèmes fédéraux tels que le Fonds stratégique d’innovation (FSI) et la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), qui injectent des milliards de dollars pour financer des projets de recherche et des capacités dans les universités, les hôpitaux et les organisations publiques et privées. Cependant, peu de cet argent est directement consacré à la commercialisation et à l’application des découvertes. C’est significatif, car cela implique des délais plus longs et réduit la valeur et l’intérêt des entreprises à s’engager dans des projets de commercialisation à long terme, en faisant passer les innovations et produits du laboratoire au marché.
L’écart entre le laboratoire de recherche et le marché est encore aggravé par le défi de la transition du laboratoire au marché. Au Canada, les start-up en biotechnologie passent souvent trop de temps dans des laboratoires académiques en raison du coût des installations, du manque d’espace et du manque d’incitatifs. Cela les empêche de développer des capacités internes importantes au-delà des étapes académiques, limitant ainsi leurs perspectives de croissance. De plus, la course contre le marché et l’exclusivité des brevets conduit souvent à des activités de R-D et de commercialisation se déroulant en dehors du Canada, entraînant des acquisitions et des accords à moindre valeur pour les entreprises canadiennes de biotechnologie.
« Mais si notre gouvernement est en mesure de poursuivre et d’accélérer davantage ses activités en matière de mise à l’échelle des mécanismes et des infrastructures de soutien aux entreprises en démarrage (…) cela pourrait encourager les compagnies canadiennes à investir davantage de temps et de ressources localement (…) »
En tant que dirigeante d’une start-up canadienne en biotechnologie, et acteur actif de l’écosystème de l’innovation aidant les start-up canadiennes en phase de démarrage, en particulier dans les sciences de la vie, à commercialiser leurs technologies à l’échelle mondiale, je ne peux garantir qu’il y a une solution simple à cet important problème. Les start-up prometteuses en biotechnologie et leurs technologies continueront de s’intéresser aux marchés au-delà du Canada, là où elles pourront générer des dépenses en R-D et se développer, et accéder à plus de financement, pour une livraison plus rapide de médicaments et de produits aux patients. Mais si notre gouvernement est en mesure de poursuivre et d’accélérer davantage ses activités en matière de mise à l’échelle des mécanismes et des infrastructures de soutien aux entreprises en démarrage, et de passer du laboratoire au marché, tout en incitant les investisseurs à prendre de plus gros risques et à s’installer localement, en augmentant les capacités de fabrication relevant des bonnes pratiques (BPF), cela pourrait encourager les compagnies canadiennes à investir davantage de temps et de ressources localement pour le développement de médicaments. De plus, l’émergence de programmes d’accélérateurs/incubateurs/entrepreneuriat soutenant les start-up canadiennes à fort potentiel de croissance au cours de la dernière décennie, tels que Creative Destruction Labs (CDL), TandemLaunch, Velocity, etc., a considérablement réduit les coûts de démarrage et fourni une assistance significative aux sociétés de portefeuille.
En raison du financement important par les gouvernements fédéral et provinciaux, et d’un marché du capital-risque plus lent, on peut toutefois douter de l’efficacité de ces programmes pour générer un retour sur investissement rentable. Un soutien accru, tant du secteur public que du milieu privé, est nécessaire pour les programmes d’accélérateurs/incubateurs/entrepreneuriat existants et nouveaux, avec des curriculums agiles, allégés et percutants. Dans les secteurs des sciences de la vie et de la biotechnologie en particulier, où les délais de R-D et de développement des produits sont extrêmement longs, ces programmes devraient être axés sur le mentorat, être immersifs, et permettre de connecter les start-up avec des investisseurs et partenaires de qualité, tout en fournissant suffisamment de financement en espèces et de ressources pour leur permettre de décoller, de croître et, au final, de devenir des entreprises saines et plus attractives, tout en naviguant sur le chemin de la commercialisation réussie.