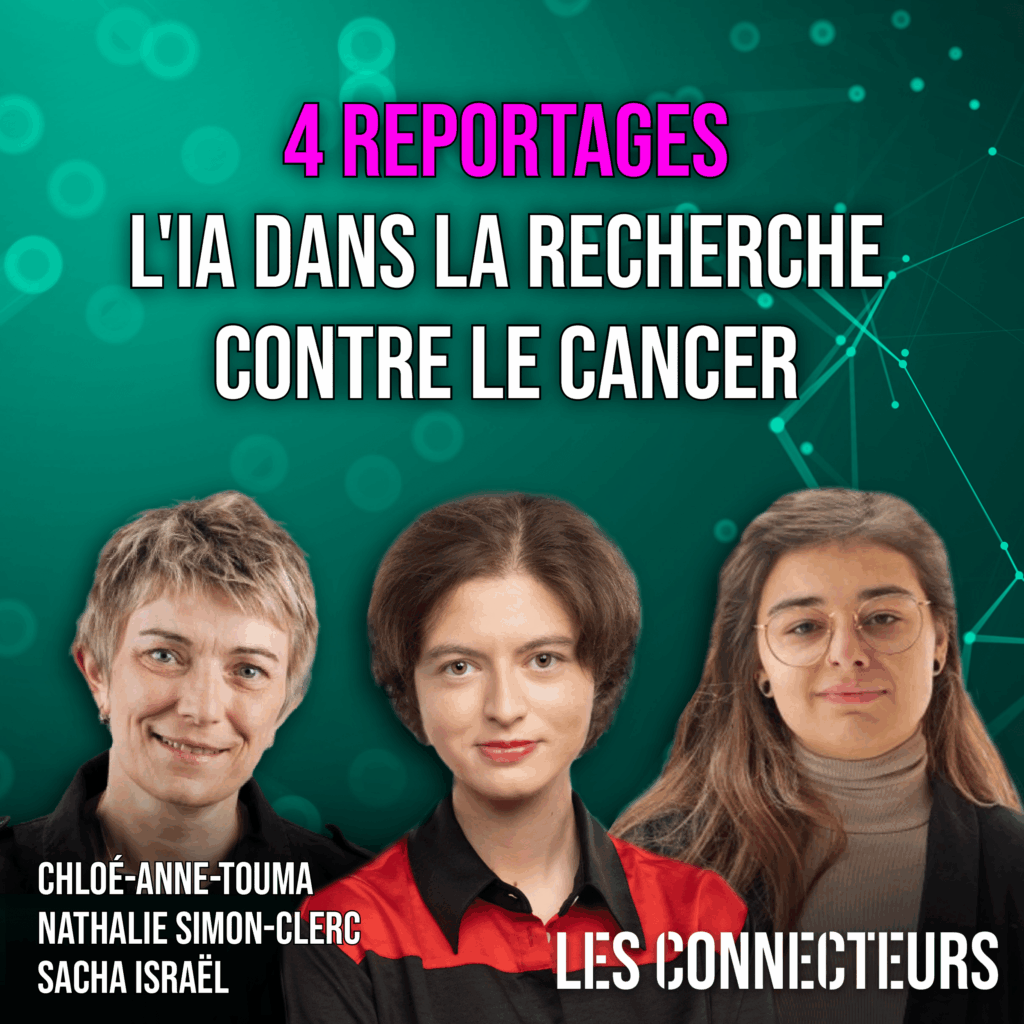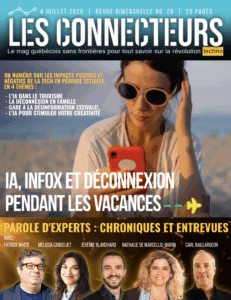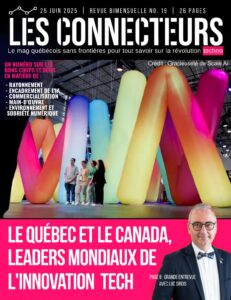La désinformation va-t-elle tuer le journalisme?

Par Nathalie Simon-Clerc, journaliste pour LES CONNECTEURS | Publié le 11 avril 2025
Le modèle médiatique parviendra-t-il à se réinventer? La chute de confiance des citoyens, la pandémie de Covid-19, l’incursion de l’IA, la désinformation et l’omniprésence des médias sociaux qui diffusent des nouvelles à l’année longue sur tous les sujets, ont mis les modèles médiatiques traditionnels à rude épreuve, parfois même jusqu’à leur disparition. Fragilisés par la loi C-18, les médias canadiens ne font pas exception à la règle. Pourtant, les journalistes de la province veulent rester optimistes et continuer de défendre une information de qualité.
Le 27 mars dernier se tenait une série de panels en lien avec la désinformation à l’ère de l’IA, organisés par le Centre de Recherche Informatique de Montréal (CRIM), en partenariat avec LES CONNECTEURS, et comptant parmi les panélistes notre rédactrice en chef, Chloé-Anne Touma, notamment pour aborder « le journalisme à l’ère de la désinformation ».
Consultez l’article tel que paru initialement dans la revue animée et interactive, ou poursuivez votre lecture plus bas
C-18 : plus de mal que de bien
La loi C-18 (Loi sur les nouvelles en ligne) au Canada, qui vise la réglementation des plateformes comme Meta et Google afin qu’elles versent une compensation aux médias canadiens, a pour l’instant contribué à invisibiliser encore plus les médias et les contenus de qualité.
« Depuis la Loi c-18, il y a absence et censure des nouvelles vérifiées sur les plateformes de Meta pour les utilisateurs canadiens, et cela va faire bientôt deux ans que des médias comme le nôtre sont bloqués sur Facebook, laissant place à de la désinformation. Parce qu’en même temps, ces plateformes décident de ne plus faire de modération, de ne plus filtrer le contenu désinformatif, haineux, etc., pour répondre à de nouvelles politiques, et le climat y a complètement changé. Nous sommes en période de campagne électorale au niveau fédéral, et personne, pas même les analystes politiques directement concernés ne parle des suites de C-18 qui, pourtant, n’a pas encore eu de retombées positives concrètes pour les médias, certains n’y ayant même pas survécu! », a déploré la panéliste et modératrice Chloé-Anne Touma, rédactrice en chef de LES CONNECTEURS, avant de lancer la balle à Patrick White, professeur à l’École des médias de l’UQAM.
« Nous sommes en période de campagne électorale au niveau fédéral, et personne (…) ne parle des suites de C-18 qui, pourtant, n’a pas encore eu de retombées positives concrètes pour les médias, certains n’y ayant même pas survécu! » – Chloé-Anne Touma
« L’hypocrisie, c’est qu’on vient d’apprendre que nos quatre partis politiques fédéraux ont acheté pour 900 000 $ de publicités sur Facebook et Instagram dans la semaine précédant le déclenchement des élections, a-t-il renchéri. On nage en pleine hypocrisie dans ce dossier! Mais la bonne nouvelle, c’est que C-18 a mené vers l’entente entre le gouvernement fédéral et Google selon laquelle l’entreprise accepte de verser 100 millions de dollars par an aux médias canadiens », d’apporter le professeur en journalisme. Oui, mais « les médias attendent toujours de voir la couleur de ces redevances, pendant qu’ils sont privés de celles de Meta, sans savoir s’ils se qualifieront pour celles de Google et si cela leur aura servi à quelque chose », a nuancé la rédactrice en chef de LES CONNECTEURS.
« (…) nos quatre partis politiques fédéraux ont acheté pour 900 000 $ de publicités sur Facebook et Instagram (…) On nage en pleine hypocrisie dans ce dossier! » – Patrick White
Une baisse de la confiance à l’égard des journalistes
Martine Turenne, rédactrice en chef de La Conversation Canada, dresse un portrait en chiffres, se référant à une récente étude de l’Institut Reuters, qui rapporte que « 40 % seulement des Canadiens faisaient confiance aux journalistes en 2023, contre 55 % en 2016. 39 % seulement croient les nouvelles qu’ils lisent ou écoutent. »
Les panélistes de la table ronde sont unanimes : les modèles d’affaires sont chamboulés et la méfiance envers les journalistes s’accroit.
« La méfiance envers les journalistes s’accompagne d’une méfiance envers les scientifiques », avertit Marine Corniou, rédactrice en chef de Québec Science.
« On assiste à un éclatement absolu de l’auditoire car il y a mille sources d’information aujourd’hui, sérieuses et pas sérieuses », se désole Martine Turenne. Elle ajoute que « la pandémie a uniformisé les contenus ajoutant à la méfiance des citoyens ».
« 40 % seulement des Canadiens faisaient confiance aux journalistes en 2023, contre 55 % en 2016. 39 % seulement croient les nouvelles qu’ils lisent ou écoutent. » – Martine Turenne
« Mais plus de 8 Français sur 10 estiment que les journalistes sont utiles », mentionne Chloé-Anne Touma, invoquant la donnée récente du baromètre Viavoice publié il y a quelques semaines.
La désinformation russe
La désinformation, qui vient maintenant des États-Unis aujourd’hui, est pointée du doigt par Patrick White : « Elon Musk change l’algorithme de X comme il veut ».
Il met également en cause la Russie et ses 10 000 sites alimentés par du contenu automatisé de propagande et, surtout, la ferme de fausses nouvelles de Saint-Pétersbourg, connue sous le nom d’Internet Research Agency (IRA), qui inonde les réseaux sociaux de rumeurs et de fausses nouvelles. L’organisme est accusé d’avoir interféré dans l’élection présidentielle américaine de 2016, d’avoir diffusé de fausses nouvelles durant la pandémie de Covid-19 et de discréditer l’Europe et l’Ukraine.
L’IA, déjà dans les salles de rédaction
L’incursion de l’intelligence artificielle dans le monde journalistique est-elle source de désinformation? « L’IA n’a pas inventé la désinformation, elle l’a exacerbée », explique Martine Turenne.
« L’IA peut aider à analyser des documents, transcrire une entrevue, traduire, analyser des résultats d’entreprise ou des résultats sportifs, mais elle ne peut pas interviewer, croiser des sources, appréhender les dimensions profondes d’un sujet. » – Marine Corniou
Pour autant, les professionnels des médias ne rejettent pas l’IA, qui est déjà présente dans les rédactions. « L’IA peut aider à analyser des documents, transcrire une entrevue, traduire, analyser des résultats d’entreprise ou des résultats sportifs, mais elle ne peut pas interviewer, croiser des sources, appréhender les dimensions profondes d’un sujet », considère Marine Corniou.
« Aucun contenu ne peut être publié sans être révisé par un journaliste, renchérit Patrick White, car le travail de l’IA est loin d’être parfait. »
Plutôt que de subir cette révolution sans prendre part au progrès, Chloé-Anne Touma pense qu’il vaut mieux tester les outils d’IA à sa disposition, en détaillant autant que possible les requêtes qu’on leur soumet, afin d’en obtenir des résultats précis et originaux, quitte à gagner du temps dans l’exécution de tâches sollicitant des compétences moins valorisantes, comme lorsqu’il s’agit de cibler des faits saillants dans de très longs rapports ou documents, traduire un reportage, ou illustrer un documentaire lorsqu’on ne dispose pas des bonnes images. Elle mentionne le numéro des LES CONNECTEURS du 19 mars 2025, consacré à l’IA dans le milieu du divertissement, qui explore la création de courts-métrages et documentaires avec une dizaine d’applications d’IA générative, et la série animée dystopique « DYSTOPOLE » qu’elle a justement créée avec de tels outils.
Inventer de nouveaux modèles
Nos panélistes préconisent de nouveaux modèles médiatiques et Patrick White se réjouit de la réussite de La Presse et du journal Le Devoir, deux modèles d’affaires différents. Selon le professeur de l’École des médias, il faut investir tous les formats : infolettre, vidéos verticales, balados…
« L’avenir est sans doute au media hyper local, spécialisé, une structure OBNL avec des partenaires, des commandites, de la philanthropie, et du sociofinancement », suggère Patrick White. Marine Corniou tempère : « Il faut passer par un modèle de soutien à l’information car on est tout seul face à des géants; l’information de qualité a un prix, les commandites aussi, c’est la liberté éditoriale. »
Éduquer à la littéracie médiatique et numérique
Les panélistes ont insisté sur la nécessité d’éduquer les jeunes générations. « Un jeune de 15 ans qui essaie de lire les médias se retrouve avec une panoplie de nouvelles. Lesquelles ont des sources fiables et lesquelles sont des fausses nouvelles? », s’interroge Martine Turenne.
Dans la province, on estime à 50 % le pourcentage de la population incapable de lire un texte compliqué. Pour autant, tous militent pour un contenu de qualité, même simple. Selon les panélistes, l’éducation à la littératie médiatique et numérique permettra d’acquérir des réflexes : quelle est la source? Le média est-il crédible? La nouvelle l’est-elle également?
Quelques chiffres de l’Institut Reuters
- 53 % des Canadiens s’informent avec la télévision, 46 % avec les médias sociaux, 14 % avec un média imprimé ;
- 72 % des Canadiens trouvent leurs informations en ligne ;
- 74 % des Canadiens francophones croient les nouvelles de Radio-Canada ;
- Youtube et Facebook sont les principaux réseaux sociaux d’information des Canadiens.