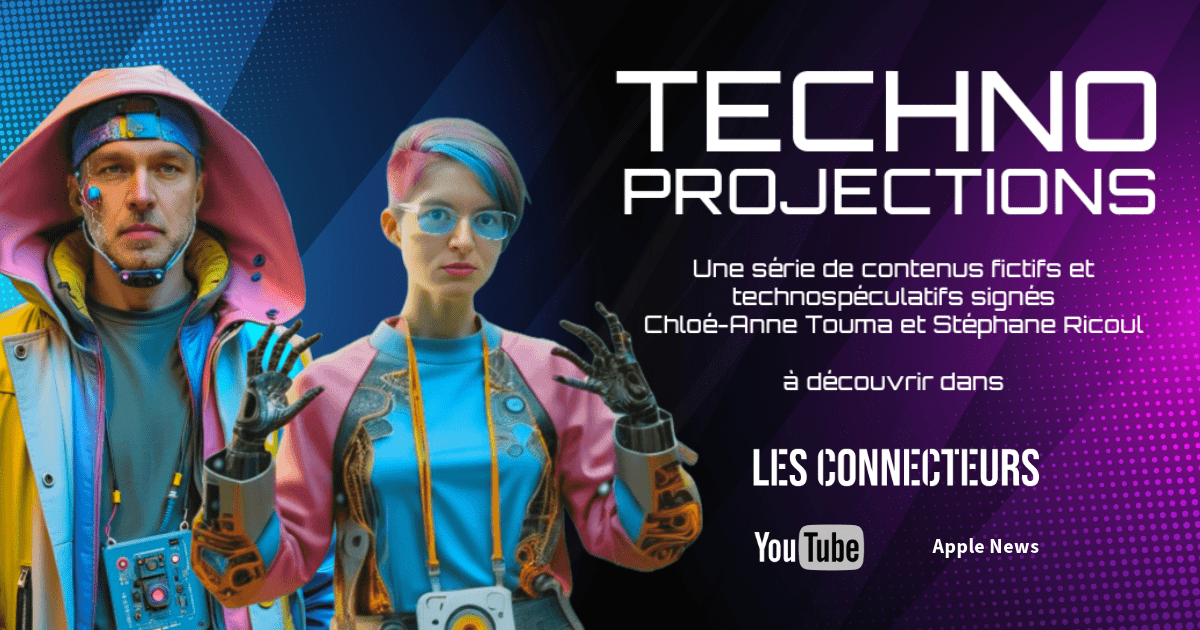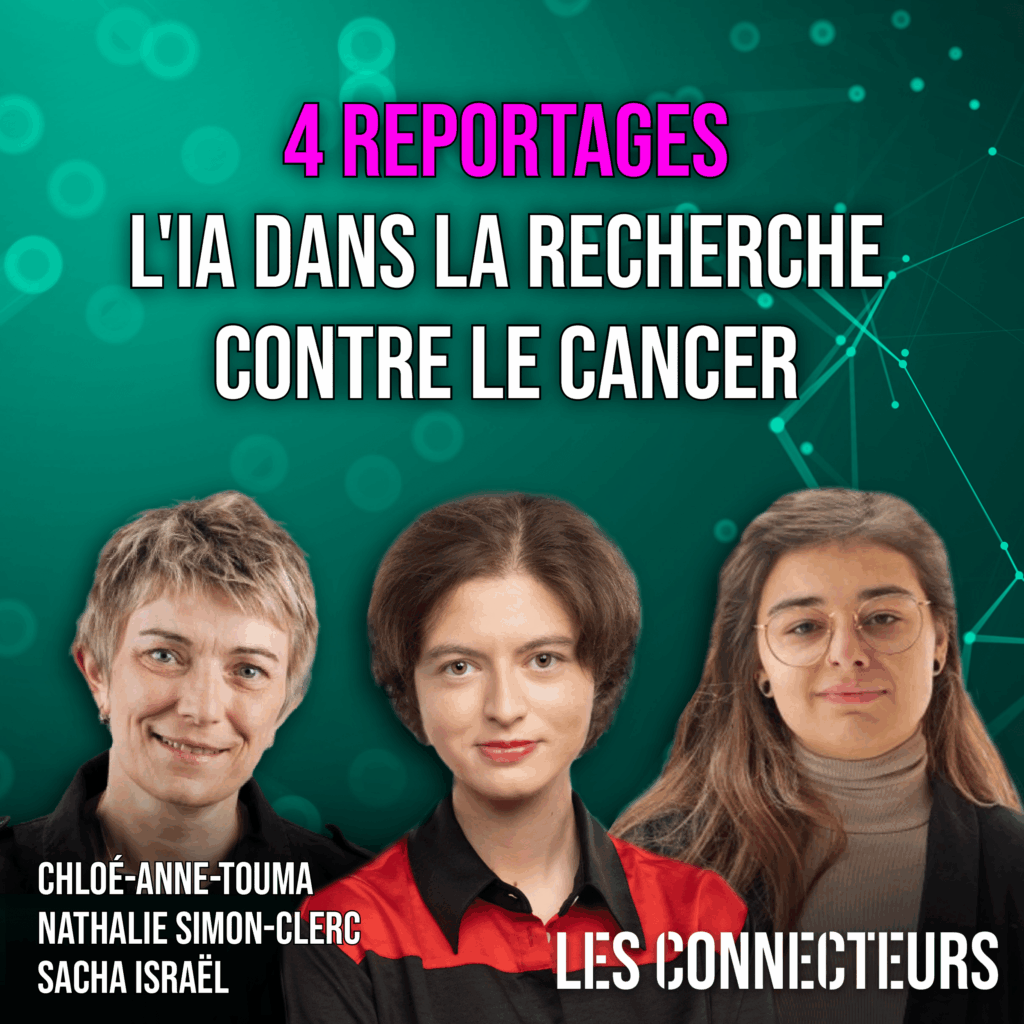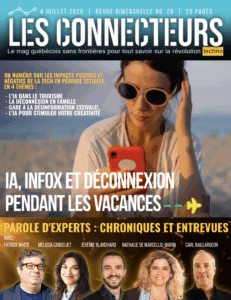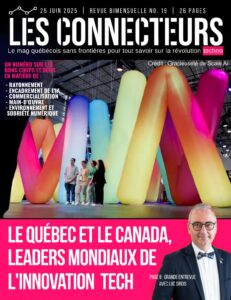Le dernier clic : autopsie d’une presse disparue
Dans ce scénario fictif, Chloé-Anne Touma anticipe les suites de la crise actuelle des médias, en se focalisant sur le Québec.
En 2030, le dernier journal imprimé du Québec avait rejoint les vitrines des musées. Les lois, censées protéger l’information en contraignant les géants du Web à partager leurs revenus, avaient paradoxalement transformé la presse en un produit de luxe – réservé à ceux capables de franchir les nouveaux paywalls imposés par les GAFAM. Fini les rédactions animées et les open-spaces climatisés. Désormais, une armée de pigistes sous-payés s’échinait à produire jusqu’à cinquante articles par jour, alimentant une machine à clics insatiable grâce à des outils d’automatisation omniprésents. Les algorithmes dictaient les priorités éditoriales, reléguant l’investigation au second plan. L’information n’était plus qu’un flux calibré pour maximiser l’engagement : titres racoleurs, contenus formatés et émotions exacerbées. Dans ce paysage déserté par le journalisme traditionnel, les rares voix indépendantes peinaient à se faire entendre, étouffées par le bruit assourdissant des plateformes numériques.
Consultez cette fiction telle que parue dans la revue animée et interactive, ou poursuivez la lecture sur cette page
La grande fracture
À Montréal, les écrans géants diffusaient en boucle des nouvelles optimistes et proagandistes : économie florissante, culture québécoise rayonnante. Pourtant, dans les rues, personne ne savait plus qui croire. Les médias traditionnels survivaient en devenant des usines à contenus sponsorisés. Un reportage sur la pauvreté? Présenté par une banque. Une enquête sur l’environnement? Soutenue par une pétrolière.
Les journalistes n’étaient plus chasseurs d’information, mais d’engagement. Leurs récompenses? Des badges virtuels et des stats d’audience. La Presse+ publiait 300 variations du même article, chacune optimisée pour un public différent. L’Agence QMI avait remplacé ses enquêteurs par des IA qui reformulaient les communiqués de presse en 17 niveaux de complexité linguistique.
L’Information en streaming
À Québec, les briefings gouvernementaux n’existaient plus qu’en format Reels. Les ministres « twistaient » leurs annonces comme des influenceurs. Les conférences de presse? Des lives TikTok où seules comptaient les réactions en direct. Les journalistes « embedded » dans les institutions publiques produisaient du contenu 24/7 – clips, stories, threads – mais ne posaient plus de questions.
La résistance digitale
Dans le sous-sol d’un café de Rosemont, un collectif de jeunes reporters maintenait le dernier vrai média indépendant. Leur arme? Une newsletter cryptée, diffusée par blockchain. Leur credo? « Un fait par jour. » Leur audience? 537 abonnés déterminés. Ils s’appelaient eux-mêmes les « Archivistes », gardiens d’une vérité qui ne rapportait plus rien. Le prix de l’abolition Les Québécois avaient gagné un monde d’information instantanée, mais perdu la capacité de distinguer le vrai du faux. Les dernières générations qui se souvenaient de l’époque des grands reportages regardaient, impuissantes, les algorithmes réécrire l’histoire en temps réel. La démocratie n’avait pas disparu – elle s’était simplement mise à… scroller.
Le prix de l’abolition
Les Québécois avaient gagné un monde d’information instantanée, mais perdu la capacité de distinguer le vrai du faux. Les dernières générations qui se souvenaient de l’époque des grands reportages regardaient, impuissantes, les algorithmes réécrire l’histoire en temps réel. La démocratie n’avait pas disparu – elle s’était simplement mise à… scroller.
Pour plus de contenus fictifs qui font réfléchir aux impacts des technologies, consultez la série Techno Projections