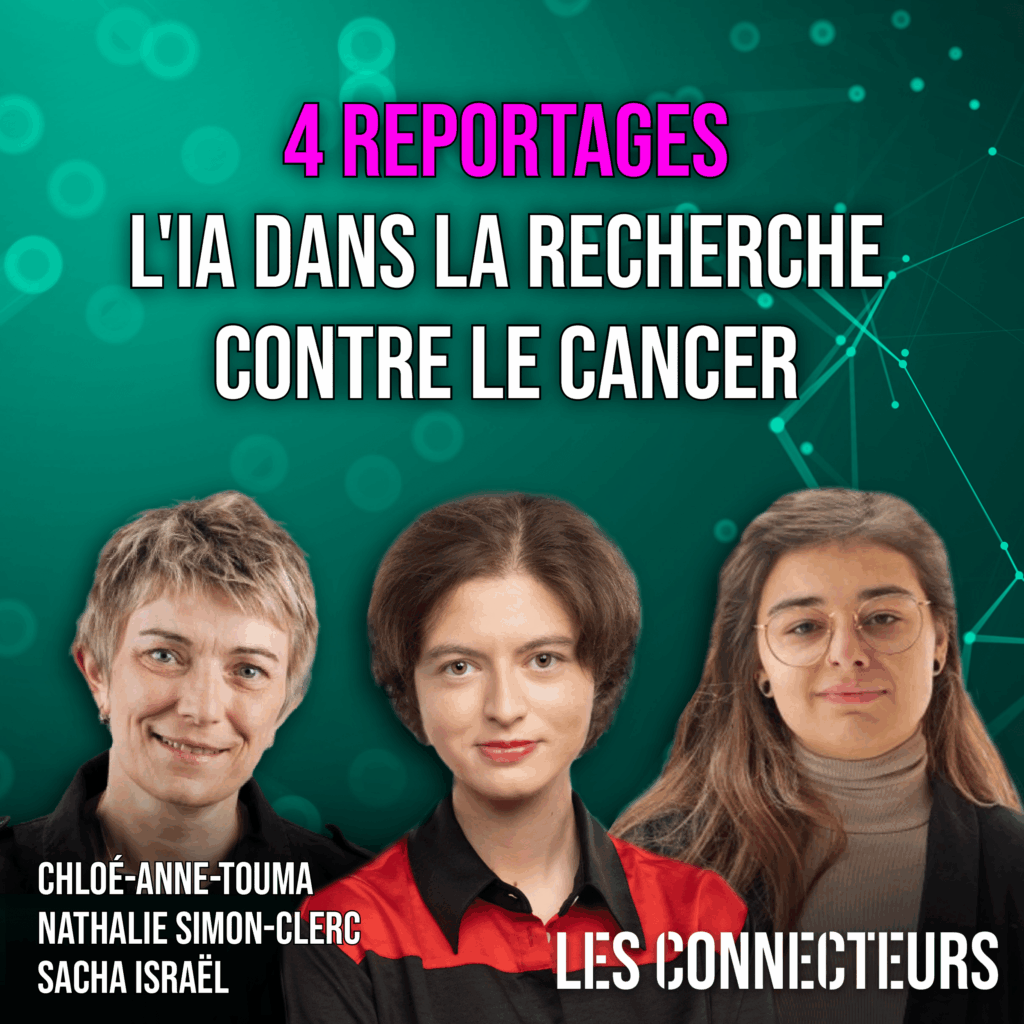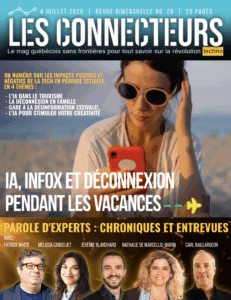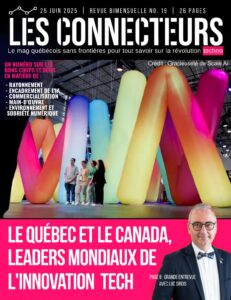Défendre l’essai-erreur : le futur du travail passe par le processus humain
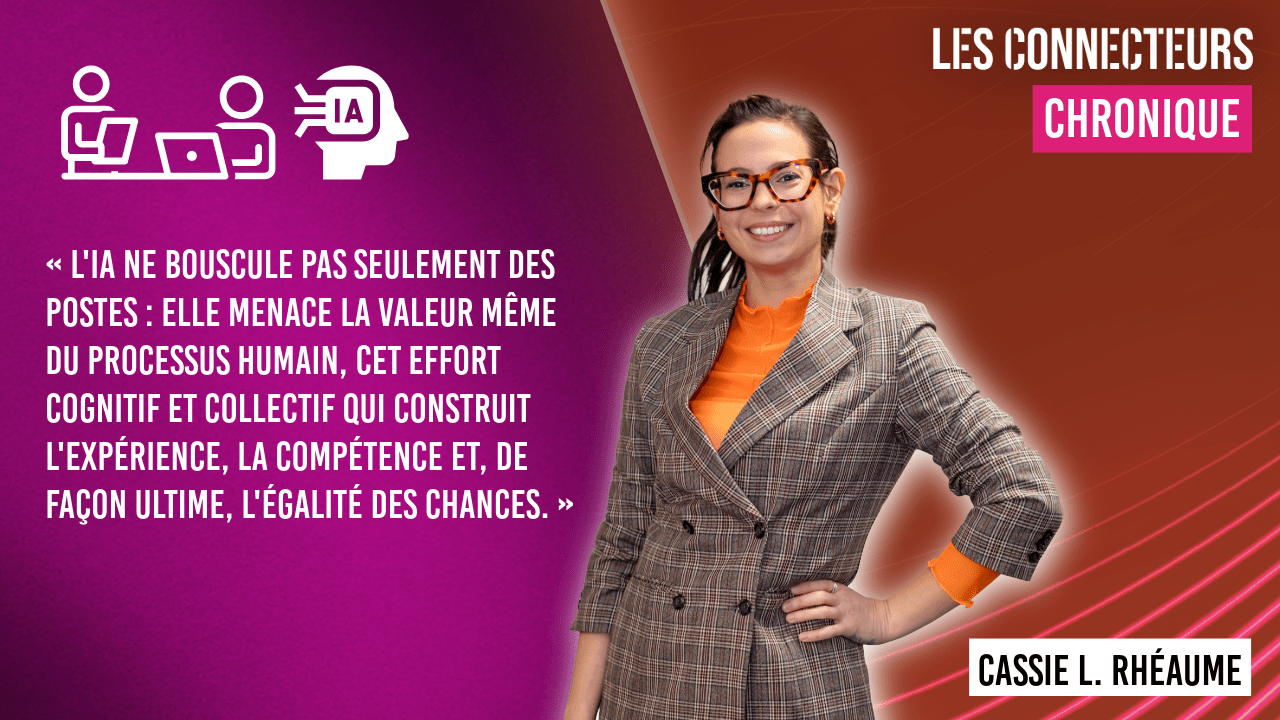
Chronique de Cassie L. Rhéaume | Publiée le 15 septembre 2025
L’excitation de cette rentrée est teintée d’un paradoxe inquiétant. Au Québec, le chômage des jeunes diplômés grimpe. Malgré des années d’études et un investissement collectif massif dans leur formation, plusieurs peinent à trouver leur place dans un marché du travail de plus en plus fragmenté. Ce paradoxe n’est pas nouveau, mais à l’ère de l’intelligence artificielle, il prend une ampleur inédite.
L’OCDE estime que 18 % des emplois sont hautement automatisables et que 32 % des tâches subiront une transformation majeure dans les prochaines décennies. Ce ne sont pas les métiers qui disparaissent d’un coup, mais les tâches qui, accumulées, fragilisent peu à peu des professions entières.
L’industrie du jeu vidéo en offre un exemple clair. Plus de 35 000 emplois ont été supprimés dans le monde depuis 2022. Les postes juniors — QA, support, tâches de production répétitives — ont été parmi les premiers sacrifiés ou automatisés. Sans juniors, pas d’intermédiaires solides. Sans intermédiaires, pas de seniors crédibles. Le pipeline de compétences se fragilise, et avec lui, l’accès à toute une industrie.
Derrière ces chiffres, il y a plus qu’une simple statistique économique. L’IA ne bouscule pas seulement des postes : elle menace la valeur même du processus humain, cet effort cognitif et collectif qui construit l’expérience, la compétence et, de façon ultime, l’égalité des chances.
Le processus humain : un luxe à défendre
La rapidité d’exécution des produits de l’IA est indéniable. Instantané, efficace, impressionnant, mais cette rapidité souhaite nous faire oublier quelque chose d’essentiel : la valeur cognitive, pédagogique ou simplement affective de ce qui se passe entre la question et la réponse.
Ces processus peuvent inclure l’essai-erreur, le doute, la recherche, la révision, le temps nécessaire pour mûrir une idée et produire un résultat qui a du sens. Autant d’étapes invisibles, aimées ou pas, mais souvent essentielles qui permettent d’apprendre, de progresser et de créer.
Et ce processus n’est pas qu’individuel : il est aussi souvent collectif. On réfléchit à plusieurs, on s’évalue entre collègues, on affine une idée grâce à la critique ou au soutien d’autrui. La valeur du travail collaboratif ne se mesure pas qu’au livrable final, mais à l’expérience partagée qui développe les compétences de chacun.
Il ne s’agit pas de faire l’éloge de la lenteur, mais de rappeler que l’imperfection, le temps investi et la collaboration font partie intégrante de la compétence humaine. Si l’on sacrifie ce processus au profit de l’instantanéité, on sacrifie aussi la possibilité de se développer en emploi.
La rupture de la chaîne de transmission
L’économiste David Autor, du MIT, insiste sur la disparition des emplois tremplins. Dans plusieurs secteurs, les tâches d’entrée de carrière — traduction, révision, recherche préliminaire — sont les premières automatisées. Or, ce sont précisément ces tâches qui formaient la relève, qui donnaient aux juniors l’expérience pour devenir des intermédiaires solides et des seniors compétents.
Cette rupture provoque un effet domino. Si l’expérience n’est plus reconnue, la qualité des emplois baisse. Si la qualité baisse, les salaires suivent. Et si les salaires reculent, c’est toute la chaîne de compétences qui s’effrite. L’histoire des transformations industrielles nous montre que la perte de reconnaissance d’une compétence entraîne une spirale descendante difficile à inverser.
Parallèlement, le monde du travail se complexifie et se densifie. Les places de prestige deviennent plus rares et plus contingentées. L’inflation des diplômes exige des niveaux de scolarité toujours plus élevés pour des postes qui nécessitent auparavant moins de qualifications formelles.
Le piège de l’hyper-individualisation
Comme le souligne la chercheuse Margarida Romero : « L’enjeu n’est pas tant d’interdire ou de généraliser l’IA, mais de garantir que son utilisation soutienne réellement les apprentissages, en préservant l’effort intellectuel. »
Transposée au monde du travail, cette idée révèle un piège. Si l’effort et la progression sont systématiquement délégués à la machine, seuls ceux qui cultivent volontairement leurs compétences garderont un avantage. Ici, le danger est de transformer cette nécessité en responsabilité exclusivement individuelle.
Le milieu numérique encourage l’individu à être entrepreneurial, autodidacte, agile. Cela peut être émancipateur, mais c’est aussi un double tranchant ; plus on mise sur la débrouillardise individuelle, plus on fragilise la solidarité professionnelle.
L’urgence collective
Les entreprises ont un rôle crucial à jouer, car la chaîne de valeur repose sur la possibilité pour les individus d’apprendre en emploi, d’acquérir de l’expérience, de devenir ces seniors compétents dont tout le monde manque. Plusieurs grandes entreprises, avec leurs académies internes, arrivent à compenser partiellement. Les PME, elles, dépendent directement de la loyauté et du développement progressif de leurs employés au fil de leurs carrières.
À cela s’ajoute une réalité : les parcours professionnels se raccourcissent. Selon le WEF, 44 % des compétences des travailleurs devront changer d’ici 2030. Ce n’est pas seulement la relève qu’il faut soutenir, mais l’ensemble de la main-d’œuvre.
Un appel à la réflexion individuelle et collective
Avant de déléguer gaiement une tâche à l’IA ou de transformer un processus pour gagner du temps, posez-vous ces questions : Quelles étapes cognitives sont en jeu ? Quelle valeur pédagogique perdons-nous ? Qu’apprend-on dans ce processus que le résultat final ne révèle pas ?
Cette réflexion est d’abord personnelle. Chaque fois que vous automatisez une tâche, demandez-vous si vous préservez ailleurs l’occasion d’exercer ces compétences, de maintenir cette gymnastique intellectuelle.
Mais si vous êtes décideur ou entrepreneur, cette réflexion devient collective. Vos choix technologiques affectent la compétence de vos équipes et la formation de la relève. Automatiser la révision peut faire gagner du temps, mais prive les juniors d’apprendre à structurer leur pensée. Déléguer la recherche préliminaire peut accélérer un projet, mais empêche l’équipe de développer sa compréhension du domaine.
Il ne s’agit pas de rejeter l’IA, mais de l’adopter de manière intentionnelle. L’IA est un outil puissant, mais chaque délégation est un choix. Faites-le en pesant non seulement l’efficacité immédiate, mais aussi l’impact à long terme sur les compétences humaines.
Certes, de nouveaux métiers émergent — en gouvernance des données, en cybersécurité, en éthique. Mais sans emplois tremplins, sans processus d’apprentissage préservé, comment et qui pourra y accéder ?
Le combat des conditions de travail et de valorisation de la compétence pourrait toucher de plus vastes secteurs professionnels dans le futur ; protéger l’essai-erreur, le doute, la recherche, le temps de travail collaboratif — tout ce qui constitue la compétence humaine. C’est aussi ça, l’urgence de la sobriété numérique : préserver la valeur du travail humain et l’égalité des chances pour tous.