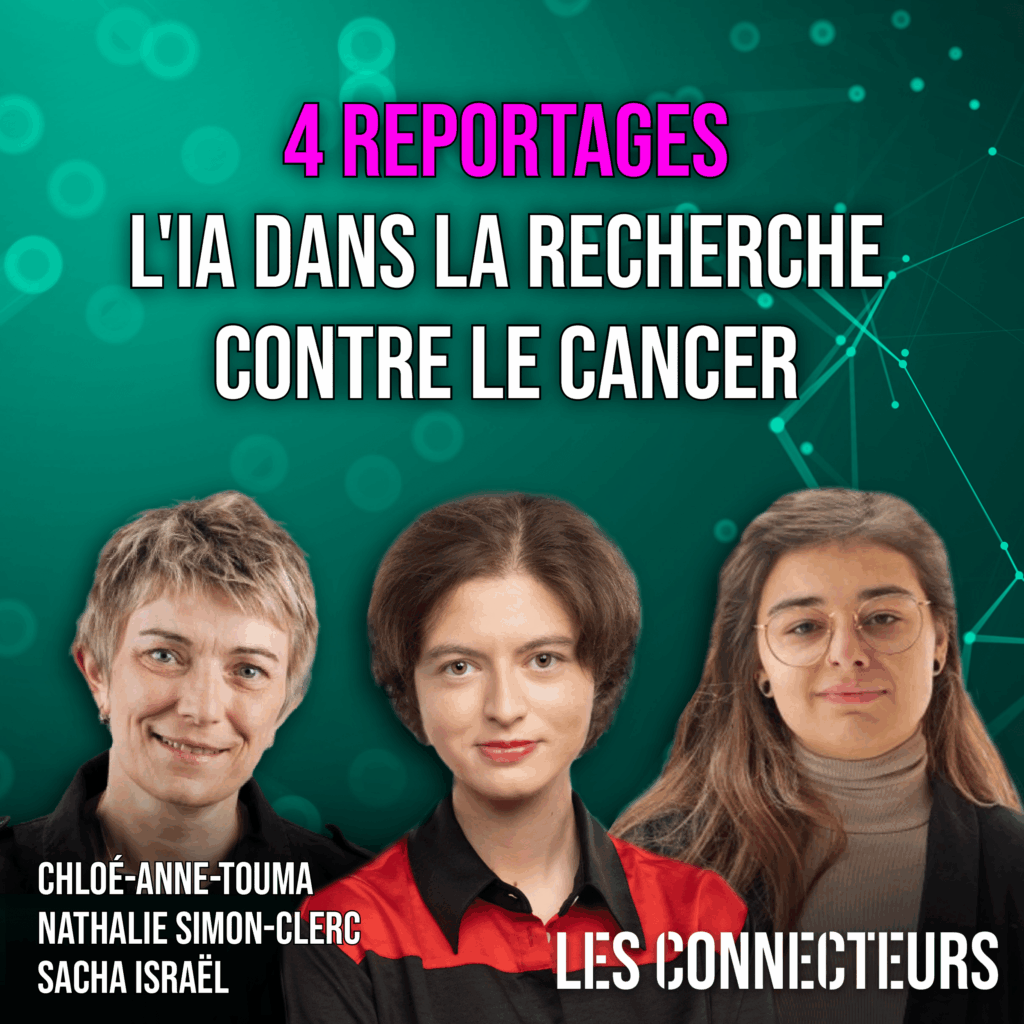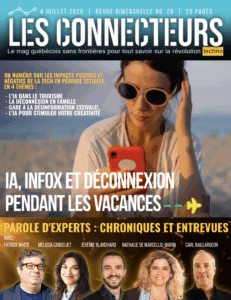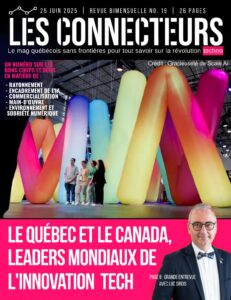Quand la technologie stimule les nouvelles formes de travail
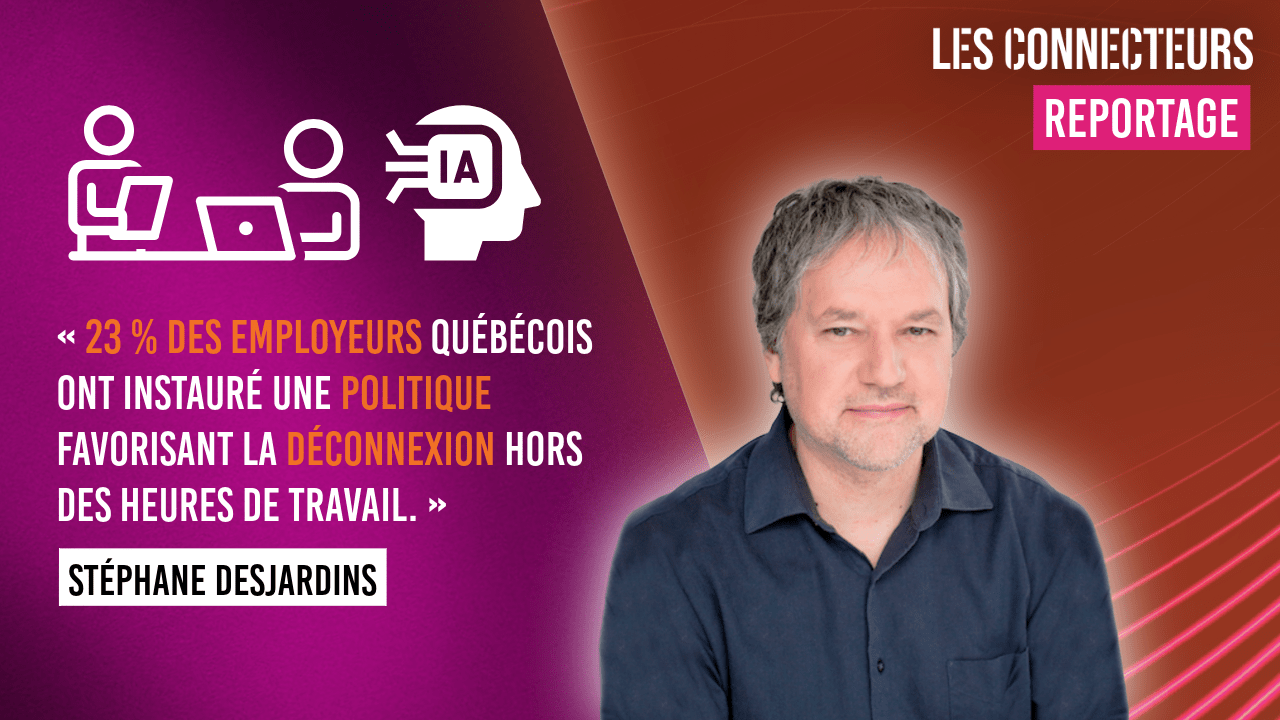
Par Stéphane Desjardins | Publié le 15 septembre 2025
Le numérique bouleverse comme jamais le monde du travail, déjà ébranlé par la pandémie.
Prenons le télétravail. Durant la Covid, il s’est généralisé là où c’était possible. Aujourd’hui, les employeurs rétropédalent et les travailleurs rechignent. « Le télétravail, ce n’est pas une nouveauté, mais les technologies l’ont accéléré, explique Diane-Gabrielle Tremblay, professeure à la TELUQ. S’il n’existait pas dans les années 1950 et 1960, internet et les ordinateurs portatifs ont permis son émergence. »
« [Le télétravail] est davantage motivé par les choix de gestion que par la technologie. Certains considèrent qu’il nuit au sentiment d’appartenance ou à la productivité. » – Diane-Gabrielle Tremblay
La généralisation de la bande passante à fort débit, les réseaux VPN et les outils comme Microsoft 365 ont fait le reste. En mai 2013, 20,1 % des Canadiens télétravaillaient, selon Statistique Canada. Mais, pour certains emplois, le télétravail est impossible. « Il est davantage motivé par les choix de gestion que par la technologie. Certains considèrent qu’il nuit au sentiment d’appartenance ou à la productivité », reprend Mme Tremblay.
Partager
La technologie (ordinateurs portables, réseaux wifi) favorise des phénomènes comme les espaces de cotravail (coworking), populaires en milieu communautaire, moins chez certaines entreprises où les travailleurs se sentent dépossédés de leur intimité et subissent le bruit ambiant. « Les employeurs cherchent surtout à économiser, ajoute-t-elle. Ça peut marcher à 15 personnes, mais à 200? »
23 % des employeurs québécois ont instauré une politique favorisant la déconnexion hors des heures de travail.
L’émergence d’outils collaboratifs (infonuagique, Google Docs, Slack) a aussi ses limites. « L’impossibilité de se brancher, d’accéder au document ou aux interventions des collègues, la multiplicité des services et les agendas partagés créent de la surcharge mentale », commente-t-elle.
Avec les alertes et les messages (courriels, textos) des téléphones et des réseaux sociaux ou corporatifs, les gens sont constamment interrompus et se sentent obligés de répondre illico. En réaction, 23 % des employeurs québécois ont instauré une politique favorisant la déconnexion hors des heures de travail, selon l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA).
À distance
La mondialisation a entraîné la délocalisation d’emplois dans des pays où les salaires sont moins élevés (soutien informatique, centres d’appels). Mais le phénomène est limité à cause de la distance culturelle, linguistique ou du manque de compétence.
Les cartes eSIM, les services d’internet satellitaire et le cellulaire abordable ont permis l’émergence des « tracances » (combinaison de travail et vacances) et des « technomades », qui peuvent travailler n’importe où sur la planète. Ça demeure marginal. D’autant plus que, pour conserver leurs privilèges de Canadiens, ils doivent séjourner au moins six mois au pays…
Menaces
La cybersécurité est devenue la préoccupation des employeurs, littéralement assiégés par le crime organisé ou certains États ayant érigé fraudes et attaques en une véritable industrie planétaire. Si la cause est technologique, la défense est psychologique. Conséquence : les employeurs doivent éduquer leurs employés en permanence et raffiner les outils de protection. L’infonuagique et le télétravail compliquent les choses.
D’autre part, nombre de travailleurs utilisent les équipements de l’employeur pour leurs activités personnelles, souvent intimes. Savent-ils que le patron a légalement le droit de les surveiller?
La technologie a favorisé l’émergence des plateformes comme Uber ou DoorDash. « La personne doit se connecter pour pouvoir travailler, reprend Diane-Gabrielle Tremblay. Si l’application juge qu’elle ne respecte pas les consignes, elle peut le débrancher. » Cette « uberisation de l’économie » est décriée partout dans le monde, car la syndicalisation est inexistante, le rapport patron-employé est robotisé et les revenus peu attrayants.
À l’inverse, grâce à la réalité augmentée, des sociétés forment leur personnel ou contrôlent à distance drones ou machinerie agricole ou minière. Cas extrême : des usines 100 % robotisées fonctionnent dans le noir.
L’IA
Enfin, l’intelligence artificielle entraîne des débats sur la surveillance des travailleurs en temps réel grâce à l’internet des objets (RFID, code-barres, téléphones, montres numériques, caméras, détecteurs).
« L’IA peut évaluer ce que font les employés, s’ils respectent les temps de travail, et peut même les congédier s’ils ne sont pas assez productifs, constate Julie M.É. Garneau, professeure agrégée au Département de relations industrielles à l’Université du Québec en Outaouais. Par exemple : Amazon contrôle le temps passé aux toilettes, des transporteurs surveillent le parcours des camionneurs… »
La professeure constate qu’il n’existe pas de régulation de l’IA en milieu de travail et qu’on ne consulte pas les travailleurs. « Comme société, on doit se doter de moyens de contrôler le développement de l’IA. Ce n’est pas ce qui se passe. »
« Tous les métiers seront transformés par l’IA. Le jugement humain étant la dernière barrière, il faut lui donner une valeur, élabore-t-elle. D’autant plus que celui de la machine n’est pas infaillible : l’IA entraîne hallucinations et biais cognitifs, car elle apprend à partir de données imparfaites. On a donc peu de contrôle sur le résultat. En gestion des ressources humaines, par exemple, l’IA écarte de bons candidats ou réfère aux mauvaises lois; seuls des avocats séparent le bon grain de l’ivraie. Et si les journalistes sont habitués à détecter les incohérences, la majorité de la population est prise au dépourvu. Dans le monde du travail, les promesses de la technologie ont leurs limites. »